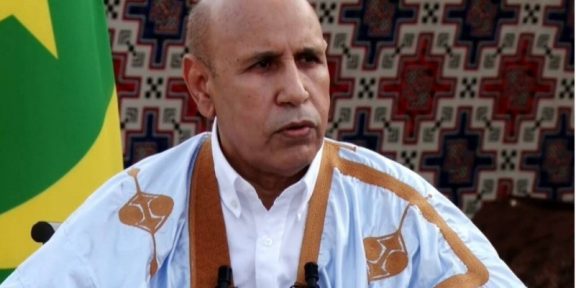L’histoire de la lutte de l’Afrique pour l’indépendance et l’unité a été marquée par de nombreux rebondissements et échecs. Cependant, nous assistons aujourd’hui à un nouveau tournant dans ce processus. Le correspondant de l’African Initiative, Gleb Ervier, s’est entretenu avec le célèbre philosophe russe Alexandre Douguine sur les chances de succès du panafricanisme et les mesures nécessaires pour y parvenir, sur les relations complexes entre les habitants du continent et sur la question de savoir si l’Afrique suivra le même chemin que l’Europe, des empereurs romains à Greta Thunberg.
— Alexandre Guélievitch, on sait que les idées d’une Afrique unie se sont développées en plusieurs étapes. Comment peut-on les caractériser ?
— Il y a effectivement eu plusieurs étapes. La première (préliminaire) était liée à Marcus Garvey (l’un des leaders du mouvement mondial des Noirs au début du XXe siècle – note de l’AI) et à l’État du Libéria. Celui-ci a été le premier produit des efforts visant à libérer les Africains. L’idée centrale était que les Afro-Américains revenant d’Amérique du Nord devaient construire leur propre État avec une idéologie africaine. Mais ça a été un échec total, car ils ont simplement reproduit l’expérience des conquérants anglo-saxons et protestants, établissant un système d’esclavage. Cela a tourné au cauchemar. Cependant, malgré ce début difficile, le retour en Afrique d’anciens esclaves transportés sur le continent nord-américain a bien eu lieu. C’est la première étape de l’émergence de l’idée panafricaine.
La deuxième étape s’est déroulée au fil de la décolonisation, des années 1930 jusqu’à la fin des années 1970, avec des soulèvements anticoloniaux dans différentes parties de l’Afrique. Des fragments d’anciennes colonies ont accédé au statut de nouveaux États indépendants, tout en conservant l’idéologie dominante des colonisateurs. Ces États étaient en quelque sorte des simulacres postcoloniaux de nations qui copiaient tout : idéologie, politique, économie. Ils avaient le choix entre le libéralisme, le communisme et le nationalisme – les trois grandes doctrines politiques du modernisme occidental. Mais au cours de cette deuxième étape, de nouvelles théories ont vu le jour. Parmi leurs idéologues figuraient Cheikh Anta Diop, Léopold Sédar Senghor, ainsi que Mouammar Kadhafi, qui, bien que musulman d’origine arabe, a proposé un projet d’unification de l’Afrique en un super-État. Il y avait donc une volonté de formuler une identité africaine à un niveau nouveau : on commençait à prendre conscience que l’émancipation politique seule ne suffisait pas si elle s’accompagnait du maintien des modèles des colonisateurs européens.
L’un des projets d’unité pour toute l’Afrique s’inspirait de l’Éthiopie, considérée comme un modèle d’État ayant préservé une monarchie ancestrale et n’ayant jamais été colonisé. Un autre projet était axé sur l’Égypte. Mais tout cela évoluait parallèlement à une indépendance politique obtenue selon les modèles des puissances coloniales, c’est-à-dire une décolonisation partielle et superficielle.
La troisième étape du panafricanisme a débuté plus récemment, dans les années 1990, avec la mondialisation. Il s’agissait alors d’une décolonisation profonde : l’idée n’était plus seulement que l’Afrique devait s’émanciper politiquement en imitant les modèles ouest-européens, mais qu’elle devait construire une civilisation africaine unique. C’est dans ce contexte qu’émergent des figures comme Mbombog Bassong, Kémi Séba, Nathalie Yamb – une nouvelle vague de panafricanistes « métaphysiques ». L’idée de Kémi Séba et de son mouvement est particulièrement intéressante : il s’oppose à la Françafrique dans son ensemble et prône un nouveau modèle de société africaine. Il affirme que l’Afrique a été la première civilisation, que les Noirs ont fait les dépositaires de la première tradition originelle et que la fin des temps obscurs, où les Blancs dominaient, approche ; la Kali Yuga, l’ère des barbares blancs, touche à sa fin, et l’ère de l’Afrique revient – un nouvel âge d’or marqué par la renaissance des cultes et religions africaines ancestrales.
C’est une direction très intéressante. Ici, on prend pour modèle l’organisation des communautés telles que des quilombos, apparues au Brésil. Les esclaves brésiliens en fuite avaient fondé dans le nord-est du Brésil un État appelé Palmares (avec une population pouvant atteindre 20 000 habitants – note de l’AI). Il a existé pendant près d’un siècle, en totale autogestion, où les Africains vivaient selon leurs propres règles et traditions. Kémi Séba considère les quilombos comme le modèle fondamental pour la réorganisation de l’ensemble du continent noir. Cette nouvelle version du panafricanisme, ou décolonisation en profondeur, correspond en réalité au modèle du monde multipolaire et s’intègre parfaitement à la théorie des États-civilisations, qui devient sans doute aujourd’hui la principale ligne directrice des relations internationales.
— Comment les différentes écoles géopolitiques perçoivent-elles le panafricanisme ? Quels sont les approches existantes et qui les représente ?
— Comme je l’ai déjà mentionné, le panafricanisme s’intègre parfaitement à la théorie du monde multipolaire, car celle-ci implique un déplacement du centre d’attention des États-nations, construits sur le système westphalien des relations internationales, vers les États-civilisations. Cette théorie est aujourd’hui la plus novatrice, avant-gardiste et avancée.
Dans les relations internationales, il existe des réalistes pour qui l’Afrique n’a pas un grand intérêt. Pour eux, tout ne dépend pas des capacités potentielles d’une civilisation à organiser son unité stratégique, mais de la situation concrète des choses. Ils se contentent d’observer et de noter l’équilibre des forces dans divers contextes régionaux, les confrontations entre États-nations et leurs problèmes internes.
Le panafricanisme suscite un certain intérêt chez les socio-libéraux, en tant que prolongement de la ligne globaliste soutenue par George Soros. Mais, en réalité, cette tendance est en train de s’affaiblir.
Dans les théories post-positivistes des relations internationales, la question africaine n’est pas non plus très développée, sauf dans certaines théories critiques. En fait, les paradigmes du colonialisme et du discours raciste restent largement présents.
L’approche eurocentriste projette simplement ses propres modèles sur l’Afrique, ce qui relègue d’emblée le continent à une position secondaire et perpétue les inégalités.
C’est pourquoi la tentative des panafricanistes de construire leur propre modèle des relations internationales pourrait s’appuyer sur une attention accrue aux communautés, aux tribus, aux langues et aux cultures. Cela constituerait une alternative aux approches rigides des réalistes et des libéraux, tout en restant compatible avec la théorie du monde multipolaire : sa flexibilité, associée à certaines approches déconstructionnistes, pourrait tout à fait convenir au mouvement panafricaniste comme méthode. Mais celui-ci doit lui-même s’intéresser de près aux écoles contemporaines des relations internationales. Car la géopolitique panafricaine n’est encore qu’un potentiel, un espace théorique réservé au sein du concept de monde multipolaire, qui doit être rempli de contenu concret. Il en va de même pour la géopolitique de l’islam, qui en est encore à ses débuts.
Si, aujourd’hui, les intellectuels africains s’emparent de cette direction, ils pourraient se retrouver en première ligne. Car aucun des États-civilisations n’a encore réellement approfondi la théorie du monde multipolaire. En Russie, nous avons commencé à lui donner une première forme. [Robert] Cooper, de son côté, a analysé la multipolarité du point de vue occidental, bien que pas encore dans des termes pleinement théoriques. En réalité, les travaux [sur ce sujet] restent rares.
Si les intellectuels panafricanistes se réveillent, ils pourraient prendre la tête de ce processus. D’autant plus qu’ils possèdent déjà une tradition de justification et de construction de leur propre identité.
— En Russie, beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi il faudrait aider des pays en développement lointains. Certains critiquent l’expérience soviétique en matière de relations avec le tiers-monde. Selon vous, pourquoi devrions-nous aujourd’hui soutenir le panafricanisme ? Peut-on distinguer des raisons culturelles et purement pragmatiques ?
— Sur le plan culturel, nous menons un combat contre l’idéologie du monde unipolaire, contre l’hégémonie globaliste. Plus il y aura aujourd’hui de pôles souverains dans le monde, plus il nous sera facile de porter ce fardeau de démantèlement de la domination libérale occidentale. En ce moment, nous avons un allié de taille en la personne des États-Unis, qui déconstruisent cette architecture globaliste de l’intérieur. Mais il est essentiel pour nous de compter parmi nos alliés le mouvement panafricaniste, qui s’engage dans un processus de décolonisation en profondeur, exactement comme nous le faisons en Russie. La Russie traverse elle aussi un processus d’affirmation en tant qu’État-civilisation, rejetant toute dépendance civilisationnelle et toute subordination à l’Occident. Certes, nous sommes dans une position bien plus favorable que les Africains, mais nous menons malgré tout un combat commun. Alain de Benoist l’avait déjà compris il y a une cinquantaine d’années lorsqu’il écrivait Europe, tiers-monde, même combat.
En réalité, la construction d’un monde multipolaire est un objectif pour toute l’humanité, une aspiration à se libérer du joug globaliste. Il est donc logique que nous soutenions nos alliés panafricanistes, car nous défendons une vision totalement alternative de l’ordre mondial.
D’un point de vue pragmatique, le business – et l’économie en général – est une structure extrêmement flexible. On peut en tirer un immense profit par la guerre, mais aussi par la paix. Par l’exploitation des ressources naturelles, mais aussi par la recherche d’alternatives à ces ressources. Par le développement des technologies, mais aussi par la suppression de certaines d’entre elles pour favoriser d’autres secteurs. On peut tirer profit de l’intégration comme de la désintégration, de l’aide financière comme du crédit, des prêts ou des subventions, et inversement.
Ceux qui pensent que l’économie est une instance stable, qui définit de manière rigide ce qui est rentable et ce qui ne l’est pas, se trompent profondément. Ils ne comprennent pas seulement les dynamiques globales, mais aussi l’essence même de l’économie. Son principe est de contourner, tel un fleuve, tous les obstacles. Elle s’adapte aux conditions pour maximiser le profit et se développer. Si vous construisez un barrage sur un fleuve, il trouvera un autre chemin : il pourra irriguer des champs ou, au contraire, inonder des terres fertiles. L’économie fonctionne de la même manière : elle s’adapte à tout. Si nous soutenons l’amitié avec l’Afrique, nous en tirerons des bénéfices. Si nous ne la soutenons pas, nous économiserons des ressources pour autre chose. Les économistes sont comme des travailleurs saisonniers ou des serveurs dans un restaurant : ils apportent simplement ce qu’on leur commande. Certains sont bons, d’autres mauvais.
L’économie est si peu autonome et souveraine dans les relations internationales que, franchement, j’ai la flemme d’en parler. Ceux qui ont réellement réussi dans ce domaine – plus ils sont riches et influents, moins ils nourrissent d’illusions sur la nature même du processus économique. Ainsi, si le panafricanisme est avantageux pour nous d’un point de vue idéologique, nous trouverons toujours des moyens d’en tirer un bénéfice matériel.
– Une question concernant le monde unipolaire : bien que son démantèlement soit manifestement une nécessité, il reste des problèmes mondiaux qui doivent être résolus ensemble. Cela est particulièrement évident en Afrique : l’ONU n’arrive pas à faire face à ces défis. Que peut offrir le monde africain pour la future régulation mondiale ?
– Oui, bien sûr, cela ne semble pas si loin. L’ONU est une structure créée dans d’autres conditions historiques, elle ne répond plus à la situation actuelle. C’est un vestige d’un autre ordre mondial, qui n’existe plus depuis trois fois. Il n’y a plus de monde bipolaire, ni unipolaire, ni même un monde sans polarité, dans lequel les mondialistes se régalaient. Il n’y a plus de système westphalien : en réalité, c’est une douleur fantomatique. Et l’ONU continue d’exister.
L’Afrique doit, sans aucun doute, participer à la construction de l’ordre mondial. C’est un immense continent, très vivant, avec une culture unique. Et la principale question est de savoir comment appréhender l’espace africain.
On peut le considérer comme une homeland, c’est-à-dire comme une patrie. Un territoire où naissent, vivent, ont des enfants, créent des familles et accomplissent des rituels les gens de cette culture.
Si l’Afrique est une « planète » gigantesque, un certain cosmos, l’objectif de l’union ou de l’empire africain à venir serait de rendre la vie ici attrayante, significative, et liée à la renaissance des fondements sacrés du monde africain. Restaurer la fierté et la dignité perdues, que les colonisateurs ont brisées à feu et à fer.
L’afrocentrisme affectera le monde entier. D’abord, la relation avec le continent changera radicalement. L’Afrique se déclarera sujet, et non objet d’exploitation ou de « pauvre décharge de l’humanité » nécessitant une aide infinie. Je pense que le flux de migrants en provenance d’Afrique, qui déstabilise d’autres régions, diminuera. Les Africains vivront dans leur propre monde, dans leur propre univers, « sur leur propre planète », en prenant soin d’elle et en l’aménageant. Les puissances multipolaires amies seront intéressées par la prospérité de l’Afrique : elles y contribueront.
D’autre part, l’Afrique dispose d’un énorme potentiel démographique, énergétique et en ressources, et elle doit absolument se diriger vers un rôle de sujet dans l’orchestre mondial. Le futur ordre multipolaire implique que le nouveau système de relations se construira justement sur la reconnaissance de cette souveraineté. Mais pour cela, l’Afrique doit véritablement contribuer. Il est nécessaire de ne pas continuer à se quereller pour de petites questions postcoloniales, mais de vraiment proposer un projet africain et de le défendre.
Konstantin Malofeïev, un homme public russe, a l’idée de la renaissance des monarchies africaines. C’est une très bonne idée. Si l’on enlève l’optique coloniale raciste, pourquoi les Africains ne pourraient-ils pas organiser leur vie en fonction de leurs propres idées sur ce qui est juste et faux, bon et mauvais, avec leurs propres traditions et croyances ?
J’avais une idée, peut-être un peu avant-gardiste et insuffisamment approfondie, selon laquelle l’Afrique devrait être gouvernée par des hommes-léopards. Des communautés qui connaissent l’Afrique, ses mécanismes secrets, ses structures cachées bien mieux que les étrangers superficiels et cruels. Le principe fondamental est que l’Afrique appartient aux Africains. Qu’ils construisent l’Afrique comme ils l’entendent, sans se soucier des autres, car les autres doivent d’abord se soucier d’eux-mêmes. Beaucoup pensent aux autres, mais ont négligé leur propre sort. Que ce soient les Européens, les Américains, ou même nous dans une certaine mesure. Il faut laisser l’Afrique aux Africains, et nous les aiderons, nous nous lierons d’amitié avec eux.
– Si je comprends bien, vous voyez ici deux approches fondamentalement différentes : la première consiste en la formation d’un sujet politique unique avec une identité unifiée, et la seconde concerne l’histoire des monarchies africaines, qui nécessiterait une identité distincte pour chaque monarchie ? N’est-ce pas que le deuxième modèle devrait passer par une série de conflits qui anéantiraient la formation de la politique panafricaine ?
– Je ne pense pas qu’il y ait un antagonisme entre ces projets. Parce qu’on peut parler de l’empire comme du plus haut niveau de la politique panafricaine. La politique panafricaine est un bon terme, et elle peut vraiment être le niveau suprême, mais les monarchies ne sont pas tout, bien qu’il existe des monarchies sacrées comme celle des Ashanti : on peut la restaurer jusqu’à aujourd’hui. Il y a des rois chez d’autres peuples, mais ils n’ont jamais revendiqué une hégémonie rigide. Il peut y avoir un empire, et à l’intérieur de celui-ci, les sujets peuvent être très variés : des monarchies, des républiques, des fédérations tribales, des fédérations intertribales. Cela signifie qu’il doit exister un niveau supérieur de la politique africaine, comme un conseil ou même un « empereur de l’Afrique », mais les sujets peuvent être collectifs. Il n’est absolument pas nécessaire qu’ils soient uniquement des monarchies, ou uniquement des États-nations, ou uniquement des républiques, ou des formations post-coloniales monstrueuses qui coupent en morceaux le monde africain. Il y a de nombreux peuples en Afrique qui ne voudront ni de monarchies, ni de républiques, ils continueront à vivre comme leurs ancêtres sans modèle social-politique imposé de l’extérieur. Par exemple, les monarchies n’étaient pas caractéristiques des Hottentots ni des Pygmées. Les monarchies existaient chez les Bantous ; chez les Zoulous, il y avait même de véritables empires. Chez d’autres peuples de l’Afrique centrale, au contraire, il y avait une organisation purement communautaire : des communautés indépendantes, des fédérations presque autonomes. L’Afrique est tellement diverse.
J’ai deux volumes dans « Noomakhia » qui en sont consacrés. Moi-même, j’ai été frappé par la diversité des différents modèles sociaux. Par exemple, la sophistication de la culture des Yoruba avec leurs institutions sacrées est presque comparable à la Grèce antique. À côté, il y a la civilisation des marécages des tribus qui distinguent à peine les esprits des morts des dieux ou des animaux. Une richesse et une diversité incroyables, y compris en termes de systèmes politiques. Parfois, les systèmes sont très sophistiqués et détaillés, et parfois très simples, voire absents. Tout cela doit, à mon avis, s’intégrer de manière organique dans le contexte de ce futur et incroyable empire africain.
Moi, j’aimerais la voir, car cela pourrait être une expérience historique absolument incroyable : la renaissance de la richesse spirituelle d’un monde aussi diversifié que l’approche coloniale a tout simplement éliminé. Ce monde a en fait été réduit à des formes de vie primitives et sauvages, et sur cette base, il a été réduit en esclavage, placé dans une dépendance totale vis-à-vis des colonisateurs. Je voudrais, au contraire, que l’illusion cognitive prenne fin et que la civilisation africaine proclame sa grandeur et sa diversité incroyables, ainsi que sa capacité à surmonter complètement, y compris les cadres épistémologiques imposés par la conscience coloniale.
– D’un côté, le processus de retour aux formes traditionnelles pourrait effectivement mener à la formation d’une politique panafricaine. Mais en prenant l’exemple de l’Union européenne, nous voyons que la communauté politique européenne a été créée uniquement lorsque l’Europe s’est pratiquement débarrassée des monarchies, à l’exception, par exemple, du Royaume-Uni. Existe-t-il dans la signification africaine (si elle existe vraiment sur le continent comme une entité unique) quelque chose de fondamentalement différent de la culture européenne, où le chemin vers l’unification a passé par le démantèlement des systèmes monarchiques, des empires ?
– Si l’on considère la civilisation européenne comme une civilisation des coordonnées cartésiennes linéaires, il est absolument impossible d’appliquer cela à l’Afrique. La structure du Logos africain est elle-même polycentrique et diverse. L’équilibre des principes apolliniens et cybéliens y est distribué de manière très étrange. Lorsque l’on commence à l’observer de plus près, on comprend que les modèles généralisants qui s’appliquent, par exemple, à la classification des différentes époques de la civilisation européenne – pré-moderne, moderne, post-moderne – ne fonctionnent pas ici. Ils conviennent en général à l’Occident. Avec des nuances, des transitions de phase complexes, en chevauchement, mais tout de même, l’Europe de l’Ouest y correspond, et l’on peut dire que l’unité européenne moderne a été construite sur la dispersion. D’abord, la destruction des empires, des monarchies, puis la transition vers le nationalisme bourgeois, et après, vers la société civile européenne, suivie de la destruction, de la disparition. Voilà donc ce que l’on pourrait appeler le crépuscule de l’Europe à la manière de Spengler. Elle s’est éteinte du Moyen Âge solaire vers le libéralisme dégénéré moderne et la dégénérescence totale, qui est déjà inscrite sur les visages des politiciens européens actuels. Tout ce chemin de héros à déviants l’Europe l’a fait, et assez linéairement : voilà le changement des Logos, le changement du soleil, puis les crépuscules et jusqu’à la nuit cybélienne d'[Annalena] Baerbock ou de Greta Thunberg aux yeux exorbités. Des empereurs romains aux adolescents souffrant de la maladie de Basedow – irrationnels, mentalement malades. Toute la ligne de l’Europe est étonnamment simple.
Lorsque nous appliquons des méthodes similaires à l’Afrique, nous ne voyons rien de tel. Dans une petite tribu peut rester un fragment, un éclat d’un passé incroyable, qui, apparemment, englobait autrefois des régions très vastes. Ou, au contraire, la culture prévisible des Bantous, qui ne présente pas de particularité particulière parmi les autres peuples nigéro-congolais, se répand dans toute l’Afrique centrale et australe. Pourtant, dans leur homogénéité culturelle, ils génèrent de nombreux pôles supplémentaires, des structures supplémentaires. On doit plutôt parler des Logos africains au pluriel. Et l’équilibre de ces éléments est incroyable. Voilà des tribus solaires saharo-nilotiques, totalement différentes de tout ce qui existe dans le monde nigéro-congolais, et pourtant elles sont elles aussi diversifiées. Il est donc incorrect d’appliquer ici quelque chose de similaire à la descente linéaire de la grandeur à la poubelle, qui représente le destin occidental.
Nous voyons qu’actuellement en Amérique il y a une révolution conservatrice, mais il est encore incertain comment tout cela va évoluer. Mais si l’on considère l’Europe, elle est restée la dernière île illustrant la séquence des phases de la dégradation sociale et civilisationnelle globale. C’est une descente, comme des marches. Mais un tel schéma ne s’applique en rien à l’Afrique. Parce que de nombreux peuples vivent parallèlement dans plusieurs univers, plusieurs temps, plusieurs phases, et portent plusieurs Logos. Et cela ne génère pas la nécessité de conflits clairs. Bien sûr, là où arrivent, par exemple, les musulmans, la situation culturelle devient plus simple. Si l’on explore l’islam africain, il sera très diversifié, complexe et multidimensionnel, mais il y a un certain dénominateur commun.
Si l’on prend en compte la diversité ethnique [du continent africain], on est ici en présence de nombreux Logos, et pour étudier l’Afrique, il faut oublier toute l’expérience européenne, simplement comme un cauchemar. Il faut laisser l’Europe chez soi. Si nous venons en Afrique, il faut découvrir l’Afrique, pas seulement les Africains. Les Africains eux-mêmes sont en grande partie déjà étrangers à eux-mêmes. Il faut chercher les gardiens de la véritable culture africaine, ceux qui portent les liens avec la vraie Afrique, celle qui dort, mais qui est sur le point de se réveiller, et dont la diversité est incroyable.
– Question concernant la diversité ethnique et religieuse : quels sont, selon vous, les principaux défis pour le panafricanisme et quelles solutions nécessitent-ils ? En République centrafricaine, j’ai parlé avec des panafricanistes locaux comme Pott-Madendama-Endzia et Socrate Gutenberg Taramboye. Ils voient bien sûr un énorme problème dans le conflit entre les identités ethniques, tribales, religieuses et l’identité politique, tant au niveau civil qu’au niveau de la conscience de soi en tant que représentants du continent africain.
– Je pense qu’il leur serait utile de se familiariser avec mon livre Ethnosociologie, qui existe en anglais et en russe. Parce que la question de la relation entre l’ethnique, le national, l’État, le politique, le civilisationnel et le social nécessite une réflexion très sérieuse. Même si nous nous basons sur les modèles occidentaux, il existe une confusion dans ceux-ci qu’il faut clarifier.
Lorsque je travaillais à l’Université d’État de Moscou, pendant plusieurs années, nous avons abordé ce problème avec un groupe d’intellectuels très avancés. Et nous avons, à mon avis, atteint des résultats méthodologiques importants. Je pense que l’idée principale de l’ethnosociologie est la diversité fondamentale, la différence d’échelle, l’absence de toute homologie entre l’ethnique et le politique.
Toute tentative de donner à l’élément ethnique une dimension politique conduit à envisager la question sous l’angle de la nation. Lorsque nous considérons l’ethnique comme national, nous modifions le champ de recherche et tombons dans une problématique insoluble. Il faut comprendre cela afin de ne pas se perdre dans les termes.
L’ethnosociologie est la clé. Lorsqu’une analyse concrète, très minutieuse et détaillée de ces termes dans les langues africaines, y compris du contexte historique de chaque notion dont nous parlons, sera réalisée, et que des dictionnaires ethnosociologiques raffinés de la vie africaine seront créés, je pense que la solution viendra d’elle-même. Parce qu’actuellement, tout le monde utilise des termes comme : « nationalisme », « libéralisme », « facteur ethnique », « conflit ». C’est-à-dire que tout le monde est prisonnier de ces concepts. C’est cela la colonisation – la colonisation de l’esprit. C’est pourquoi la question de la décolonisation de la terminologie est aussi un sujet sur lequel nous travaillons actuellement.
La Russie est dans la même situation, il n’y a rien de grave. Il suffit de commencer à démêler progressivement, pas à pas, ces terribles amas qui existent, et les Africains eux-mêmes verront la solution dans le fait de simplement donner un autre nom à tel ou tel phénomène, surtout s’ils choisissent les bons termes. Dans le confucianisme, ce processus s’appelle « rectification des noms » : lorsqu’une chose est correctement nommée, elle cesse d’être un problème. Le problème réside dans une chose mal nommée.
– Sur quelles bases universelles peut être construit un code culturel commun pour différents peuples africains ?
– Je pense qu’il faut avancer l’idée d’une identité africaine plurielle, avec plusieurs couches. Une approche historico-linguistique serait probablement la plus utile ici. Parce que si nous considérons l’Afrique sous un angle linguistique, en établissant une carte ethnolinguistique et en la prenant comme base d’une identité africaine unifiée, nous pourrons comprendre et surmonter de nombreux problèmes. Cela, il me semble, doit être le point de départ. Il est essentiel de toujours garder cela à l’esprit, sans jamais glisser vers les droits de l’homme européens, l’humanisme : tous ces termes n’ont aucun sens pour l’Afrique. Ils ont été apportés par les colonisateurs dans le but, principalement, d’exploiter la population locale. Il faut revenir aux racines. La langue compte, l’ethnie compte, les racines ethniques comptent, la culture compte. Il faut les examiner sous les couches coloniales superficielles, pénétrer dans les racines ethnoculturelles qui existaient avant que des identités plus superficielles ne soient introduites. Cela est très important.
En Afrique, il est nécessaire de cultiver l’aspect archaïque et de progressivement développer une conscience de l’unité complexe et plurielle de l’Afrique. Mais l’idée principale est de penser en termes du continent africain, de toujours le garder à l’esprit, de comprendre le lien avec le sol, la culture, la métaphysique de ce lieu unique et, partant de l’unité comprise, de construire des projets plus concrets – de transport, économiques, militaires, stratégiques. Il faut construire un empire africain continental, en s’appuyant sur un noyau, qui, à mon avis, devrait reposer précisément sur des conceptions ethnoculturelles et linguistiques de l’identité panafricaine. Il ne faut pas chercher un dénominateur commun dans un des peuples, une des cultures, une des idéologies. Le dénominateur commun doit être l’espace même de l’Afrique. Et tout le reste, plus cela sera diversifié, mieux ce sera. C’est l’unité et la diversité – de l’Afrique.
Une unité et une diversité, dans lesquelles il existe une sensation très subtile, qui traverse tout, de participation commune et, en même temps, de diversité des formes, chaque civilisation ayant la sienne. Il faut atteindre cela. C’est un défi pour les nouvelles générations de panafricanistes.
– Est-ce qu’il est utile, sur un plan pratique, peut-être même graphiquement, de représenter l’arbre généalogique des identités, l’arbre de la culture africaine ? Expliquer aux gens comment elles sont interconnectées et où ces identités ne sont pas en conflit les unes avec les autres ? Comment une personne peut être à la fois membre d’une tribu, d’une profession, d’un peuple et en même temps un être humain africain ?
– Oui, on peut dire cela. Mais tout d’abord, il faut éliminer cette couche coloniale de la Françafrique, la détruire pour qu’il n’en reste aucune trace. Il faut tout simplement expulser les traces des colonisateurs britanniques, ne pas leur prêter attention, ne rien écouter d’eux. Si un Européen arrive avec un air arrogant et veut enseigner quelque chose, il doit être renvoyé immédiatement, lui donner un billet pour le retour. Je pense qu’il est nécessaire de déporter les porteurs de la conscience coloniale. L’Afrique doit être pour les Africains. Si un ami arrive, qui aime l’Afrique et est d’accord avec cela, c’est une autre histoire. Mais s’il vient pour enseigner quelque chose, c’est assez.
Il faut se débarrasser des modèles coloniaux du monde occidental, puis dessiner, comme vous l’avez dit, une carte systématique, détaillée de l’Afrique ethnolinguistique et ethnoculturelle.
Regardez, par exemple, le Congo et le Rwanda. Qu’est-ce que c’est ? Ce sont deux créations coloniales. Quelle différence cela fait-il où vivent les Tutsis et les Hutus ? Toutes les frontières qui existent entre ces États supposés et en général tous les États africains sont le produit des disputes coloniales des colonisateurs. Ce sont des disputes entre eux, les seigneurs blancs, qui ne prenaient absolument aucune considération pour les peuples africains. Ce sont toutes des traces horribles, comme des cicatrices sur un corps torturé.
Dès que nous dessinerons ce schéma dont vous parlez, nous verrons une Afrique totalement différente – une Afrique des peuples et des groupes linguistiques. Il existe des frontières, des points de rencontre, des zones de contact ; tout cela n’a pas nécessairement un caractère politique. Il faut complètement effacer ces frontières, oublier l’expérience coloniale, la surmonter et reconstruire l’architecture de l’unité africaine à nouveau. Mais il faut creuser plus profondément que l’époque coloniale, y compris l’époque des conquêtes islamiques, car elle aussi était coloniale.
Gleb Ervier